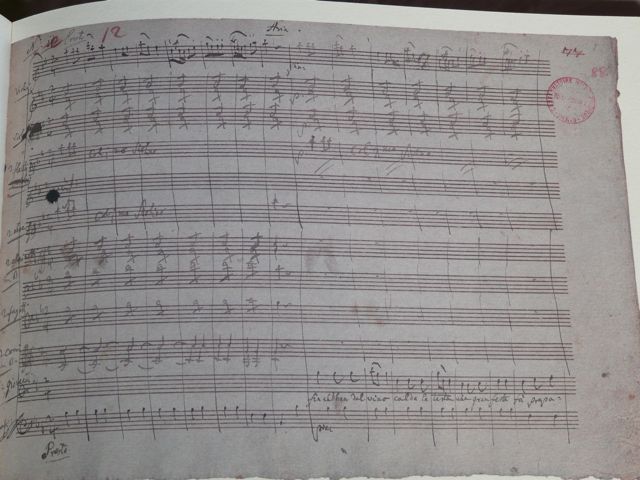Dans
ma pièce la statue du Commandeur ne parle pas, ne marche pas et ne
va pas souper en ville [1].
Trivialité
terrestre, Leporello s'est plaint à l'avant-scène. Don Giovanni,
Donna Anna, le Commandeur sortent de nulle part, pour un Prologue
dans le ciel en plateau vide et nuages d'orage, représentation
du défi ironique lancé à la nature et au créateur. J'ai déjà
dit que Donna Anna fait pendant à Don Juan. Ne peut-on supposer
qu'elle est destinée par le Ciel à révéler à Don Juan la part
divine de sa propre nature, et, en l'arrachant au désespoir de ses
vains efforts, à le sauver par l'amour même dont Satan s'était
servi pour le corrompre ? [2]
L'homme
sans visage se démasque à l'agonie du Commandeur. Et les arbres
choient des cintres. Retour sur terre ?
Quelle
est donc la signification de ces arbres descendus, qui remonteront
d'un cran, puis de deux, découvrant leurs racines, avant de
disparaître à nouveau ? Allégorie d'un Don Giovanni s'enfonçant
progressivement six pieds sous terre ? mangeant déjà les arbres par
la racine depuis le tréfonds de l'enfer ? Opposition de l'immobilité
et de la frénésie du héros pris dans le vertige du temps qui
passe ? [3] La note d'intention sans intention laisse sur une
faim sylvestre.
Sur
un sol miroir où, du balcon, on pourrait voir sous les jupes des
filles, et dans de toujours très belles lumières de Jean Kalman, se
côtoient robes de soirée et pantalon de cuir, perruques poudrées
et costumes trois pièces, XVIIIe et années soixante.
Volonté d'intemporalité ou confusion de vestiaire ?
De
très beaux masques animaliers font irruption en trio au bal où l'on
ne danse ni ne contredanse ; et Don Giovanni donnera la sérénade à
la coulisse.
Les
figurants figurent et restent là, dans une absence de mouvement
incompréhensible, lorsque Don Giovanni indique aux uns (accennando
a destra) d'aller par ici et aux autres (accennando a
sinistra) d'aller par là.
Un
cimetière blanc meringue émerge des dessous, intrication étriquée
de tombes et de statues dont les cheveux (ou les cerveaux ?) leur
dégoulinent sur le visage, et dans lequel Don Giovanni et Leporello
essaient de se mouvoir, laissant vacant le reste du plateau.
L'ultime
dîner en forme de pique-nique, nappe par terre à cour et musiciens
de scène en dentelles, bas, perruques, mouches et lunettes de vue à
monture rouge sur des chaises d'époque à jardin, fait également
souffrir la statue du Commandeur et sourire le spectateur : lunettes
de piscine et costume farinés, elle doit traverser tout le plateau
pour atteindre son hôte, marchant comme un HRP2 mal programmé qui
se serait échappé de son portique.
À
l'ouverture, la basse ne traîne pas, la résonance d'une église,
d'une voûte ou d'un sépulcre [2] est gommée. L'orchestre
surélevé est souvent trop fort et les décalages entre fosse et
plateau, voire entre musique de scène et solistes, sont nombreux.
Don Giovanni est dans l'urgence, tempo non ha. Ses mots s'effacent
derrière la vitalité d'une « force qui va », à toute vitesse.
C'est d'ailleurs le seul élément que nous retiendrons de l'air du
champagne. Un simple tempo, presto, pour une unique
caractérisation [5] : de manière surprenante, Fin ch'han
dal vino est donné ici plutôt andante, par un galant
plus désabusé qu'énergique, comme s'il savait déjà qu'il
n'ajouterait pas une dizaine de noms à sa liste avant le matin.
Tamar
Iveri, qui avait donné une belle Vitellia dans la Clemenza
l'an passé n'est à l'aise ni dans la robe ni dans la voix de Donna
Anna, et crie désagréablement ses aigus. En revanche, Dmitry
Korchak, faux airs de Roberto A. dans un strict costume trois pièces,
réussit une vraie présence vocale et scénique en Don Ottavio.
Vannina Santoni fait une Zerline à peine coquine tandis que son
Masetto, Ipča Ramanovič, est un peu emprunté, plus timide en voix
et en jeu que lors de son récital (*).
Maité
Beaumont tire son Elvire tantôt du côté ridicule, tantôt du
côté du plus touchant pathétique [4] ; elle exagère justement
le trait de cette aristocrate dont le comportement extravagant est
inadapté à sa condition sociale [4]. On la préférait
cependant dans le travesti de Sesto.
Leporello
de secours le dimanche, Don Giovanni le mardi, Kostas Smoriginas a
l'audace, le physique et la voix qui font les futurs grands. Son
aisance scénique et son beau baryton séduisent immédiatement.
Troisième Leporello appelé en catastrophe et tout juste débarqué
de l'avion, Roberto de Candia endosse facilement le costume sur sa
rondeur bonhomme. Un peu tendu sur son premier air, il donne un
Catalogo peu théâtral, mais prend confiance ensuite.
Intégrant facilement la mise en scène – ce qui n'est guère
compliqué, les chanteurs étant souvent à la rampe face public –
il confère à la scène du balcon (ou plutôt de la passerelle) un
comique très réussi, en valet lourdaud singeant son maître.
En
2005 Don Giovanni réapparaissait après sa descente aux enfers,
enlaçant une jeune femme. En 2007, il ne réapparut point. En 2013,
il réapparaît de nouveau. Le mythe est éternel une fois sur deux.
Mais on ne sait toujours pas où vont les arbres.
[1]
Carlo Goldoni, Mémoires, Paris 1787. In Jean-Philippe
Grosperrin, Le code et la licence : Don Giovanni dans le système
théâtral des aristocrates, Journée d'étude « Don
Giovanni, les mille et trois visages d'un séducteur », Théâtre
du Capitole, 27 mars 2013.
[2]
E.T.A. Hoffmann, Don Juan. Contes – Fantaisies à la manière
de Callot, tirées du Journal d'un voyageur enthousiaste, 1808-1815.
Folio classique
[3]
Gilles Cantagrel, L'ogre du temps. In G. Cantagrel, C. Massip
et E. Reibel, Don Giovanni, le manuscrit, Bibliothèque
nationale de France / Textuel 2005
[4]
Michel Noiray, Don Giovanni, Avant Scène Opéra n° 172, 1996
[5]
Emmanuel Reibel, Les
métamorphoses de Don Juan.
In G. Cantagrel, C. Massip et E. Reibel, Don
Giovanni, le manuscrit,
Bibliothèque nationale de France / Textuel 2005
Théâtre
du Capitole, 26 mars 2013
(*) Les Midis du Capitole, 21 mars 2013
(*) Les Midis du Capitole, 21 mars 2013